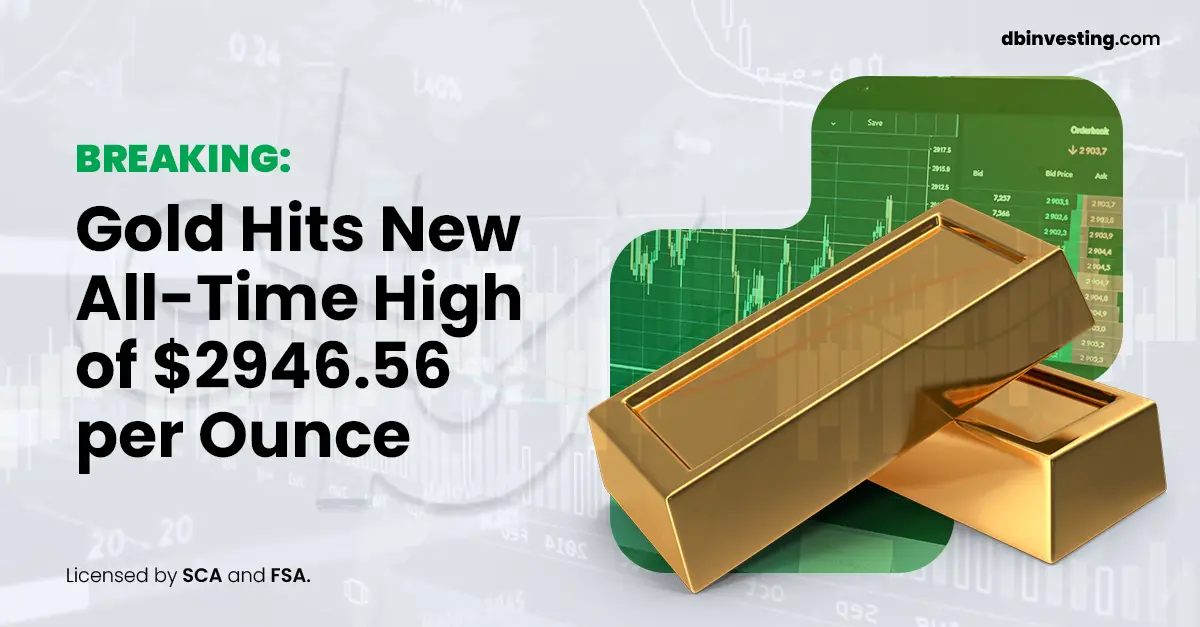Ce que les traders doivent savoir
Au début du mois d’avril 2025, la guerre commerciale mondiale s’est brusquement intensifiée avec une nouvelle vague de tarifs douaniers réciproques entre les principales puissances économiques. Les États-Unis ont déclenché ce cycle en annonçant des droits de douane sans précédent visant à la fois leurs alliés et leurs rivaux, suscitant des réponses rapides de la part de la Chine et d’autres pays.
Ces développements rapides ont ébranlé les marchés financiers mondiaux. Les indices boursiers, les prix des matières premières et les monnaies ont fluctué à chaque annonce. Vous trouverez ci-dessous une chronologie détaillée des événements survenus entre le 1er et le 15 avril, suivie d’une analyse de l’impact sur les marchés, des motivations politiques et des avertissements fondés sur les avis d’experts et d’institutions internationales.
La dernière escalade de la guerre commerciale : chronologie des événements
2 avril 2025
Les États-Unis lancent une attaque tarifaire globale :
Le président américain Donald Trump a annoncé l’imposition de droits de douane “réciproques” à la plupart des pays du monde, avec un taux minimum de 10 %. Les nouveaux tarifs comprennent un prélèvement de 25 % sur les importations européennes de voitures, d’acier et d’aluminium, et de 20 % sur presque tous les autres produits en provenance de l’Union européenne, ainsi que de 26 % sur les importations indiennes et d’autres pays.
L’administration a décrit cette mesure comme un moyen de protéger les industries américaines et de parvenir à l'”équité” dans le commerce. La décision a provoqué un choc généralisé, le secrétaire américain au Trésor ayant déclaré que les partenaires commerciaux – y compris les alliés – n’avaient pas fait de concessions suffisantes, ce qui a conduit à cette action unilatérale visant à obtenir un levier de négociation. Sur le plan intérieur, les données du début du mois d’avril ont montré une pression croissante sur les consommateurs américains et les industries qui dépendent des intrants importés. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a averti que ces droits de douane américains imposeraient “des coûts élevés aux consommateurs et aux entreprises aux États-Unis” et causeraient des dommages importants à l’économie mondiale.
4 avril 2025
La Chine répond en nature :
La République populaire de Chine est devenue le premier pays à prendre des mesures de rétorsion directes contre les nouveaux tarifs douaniers de M. Trump. Ce vendredi, Pékin a imposé des droits de douane de 34 % sur tous les produits américains, ainsi que des restrictions strictes sur l’exportation de métaux stratégiques à base de terres rares vers les États-Unis. Les responsables chinois ont qualifié les droits de douane américains d'”acte d’intimidation unilatéral”, soulignant que la Chine ne tolérerait pas les violations de sa souveraineté et de ses intérêts en matière de développement. Les marchés financiers ont immédiatement perçu le danger et les bourses mondiales ont été prises de panique, les investisseurs craignant de plus en plus que les deux plus grandes économies du monde ne s’engagent dans une guerre commerciale à grande échelle.
5 avril 2025
Les droits de douane américains entrent en vigueur dans le monde entier :
À cette date, les droits de douane américains de 10 % sur la plupart des importations en provenance de pays du monde entier sont entrés en vigueur. Malgré les objections de ses alliés, Washington a poursuivi la mise en œuvre de ces droits de douane considérables.
Les marchés émergents, en particulier dans la région Asie-Pacifique, ont connu d’importants bouleversements, car leurs économies, fortement exposées à la demande américaine, étaient particulièrement vulnérables à ces droits de douane. Toutefois, des documents de la Maison Blanche ont révélé que des exemptions temporaires pouvaient être accordées à certains partenaires. De nombreux alliés ont saisi cette occasion pour négocier ; des pays comme l’Indonésie et Taïwan ont annoncé qu’ils ne prendraient pas de mesures de rétorsion similaires mais s’en tiendraient à des solutions diplomatiques, tandis que l’Inde a rapidement cherché un accord rapide avec Washington pour éviter l’escalade.
En effet, l’Inde a confirmé qu’elle n’imposerait pas de contre-tarifs sur les importations américaines, qui étaient taxées à 26 %, citant les négociations en cours visant à parvenir à un accord commercial d’ici à l’automne 2025. Le gouvernement indien, dirigé par Narendra Modi, a également pris des mesures pour gagner les faveurs de Washington, comme la réduction des droits de douane sur les motos de luxe et le bourbon américains, et la suppression de la taxe sur les services numériques visant les grandes entreprises technologiques américaines.
7 avril 2025
Nouvelles menaces et efforts européens de désescalade :
Après un week-end riche en déclarations, Donald Trump a brandi lundi 7 avril une nouvelle carte à jouer. Il a menacé d’imposer des droits de douane supplémentaires de 50 % à la Chine si celle-ci ne revenait pas immédiatement sur ses dernières mesures de rétorsion.
Cet avertissement public faisait suite à une réunion à huis clos à la Maison Blanche au cours de laquelle l’équipe économique de M. Trump a évalué l’absence de signaux de désescalade de la part de Pékin. Pendant ce temps, l’Europe a intensifié ses efforts diplomatiques pour éviter une nouvelle extension du conflit.
À Bruxelles, la présidente de la Commission, Mme von der Leyen, a déclaré que l’Union européenne était prête à négocier avec Washington, proposant même une initiative “zéro pour zéro” visant à éliminer tous les droits de douane réciproques sur les produits industriels. Elle a confirmé que cette offre restait sur la table, mais qu’elle était subordonnée à la condition que les États-Unis renoncent à l’escalade. Elle a également souligné que l’UE était prête à prendre des contre-mesures pour défendre ses intérêts en cas d’échec des négociations, notamment en protégeant l’Europe des effets secondaires de la modification des routes commerciales mondiales.
Dans le même temps, les ministres du commerce de l’UE ont convenu de donner la priorité au dialogue avec Washington plutôt qu’à des représailles immédiates afin de tenter de contenir la crise. Au milieu de ces efforts, les indicateurs boursiers, y compris ceux de Wall Street, ont fluctué à chaque nouvelle fuite ou déclaration, les investisseurs attendant le moindre signe d’une percée dans les négociations entre les États-Unis et leurs partenaires.
8-9 avril 2025
Une escalade sans précédent des droits de douane américains :
Dans la soirée du 8 avril, en l’absence de signaux de désescalade de la part de Pékin, M. Trump a mis sa menace à exécution et a de nouveau augmenté les droits de douane sur les importations chinoises. À la surprise générale, Washington a ajouté 50 points de pourcentage à ses droits de douane sur la Chine, portant le taux cumulé des droits de douane sur les produits chinois à 104 % à compter du 9 avril.
La Maison Blanche a confirmé que cette augmentation substantielle resterait en place “jusqu’à ce que la Chine parvienne à un accord commercial équitable” avec les États-Unis. Cette escalade était une réponse directe au refus de la Chine de réduire ses droits de douane de 34 % sur les produits américains.
Dans le même temps, l’administration américaine a dévoilé une double stratégie : intensifier la pression sur la Chine tout en suspendant temporairement certains des nouveaux droits de douane pendant 90 jours à l’égard d’un certain nombre de pays alliés. Cela a permis à des partenaires comme l’Union européenne, le Canada et le Mexique de négocier pendant cette période de grâce au lieu de s’engager immédiatement dans une confrontation commerciale.
Cette décision a contribué à un calme relatif sur les marchés en ce qui concerne les alliés des États-Unis, mais a isolé davantage la Chine sur le plan économique. En réponse, le ministère chinois des finances a annoncé le 9 avril au matin qu’il porterait à 84 % les droits de douane supplémentaires sur les produits américains.
Les responsables chinois ont décrit cette décision comme défensive et comme une mesure de rétorsion en réponse à la dernière augmentation des droits de douane des États-Unis. Un porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères a souligné que la Chine “continuerait à prendre des mesures décisives et efficaces pour protéger ses droits et intérêts légitimes”, insistant sur le fait que la Chine ne succomberait pas aux pressions ou menaces extérieures.
Ces hausses tarifaires ayant été rapidement échangées, les marchés mondiaux ont plongé dans une forte volatilité, la moyenne industrielle Dow Jones perdant plus de 5 000 milliards de dollars de valeur boursière en deux jours en raison de la panique déclenchée par ces développements.
10 avril 2025
Consolidation de la position américaine et allégement partiel de certains droits de douane :
Le 10 avril, l’administration américaine a clarifié les détails de la nouvelle structure tarifaire. La Maison Blanche a confirmé via CNBC que le taux cumulé des droits de douane sur la Chine avait en fait atteint 145 % après la dernière augmentation.
Ce chiffre comprend un nouveau droit de 125 % sur les marchandises chinoises en plus du droit de 20 % imposé plus tôt cette année en réponse à la crise du fentanyl.
Ainsi, les droits de douane américains sur toutes les importations chinoises ont atteint un niveau sans précédent. Dans le même temps, Washington a cherché à atténuer certains des effets négatifs sur les consommateurs américains et le secteur technologique. Le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a annoncé que les smartphones, les ordinateurs et certains produits électroniques grand public seraient exemptés des nouveaux droits de douane, car la plupart de ces produits sont importés de Chine par des entreprises américaines.
Les analystes ont noté que l’exemption des produits électroniques et les allusions de la Maison Blanche à un éventuel assouplissement des droits de douane sur les voitures ont quelque peu soulagé les actifs à risque tels que le pétrole et les actions.
D’autre part, M. Trump a laissé entendre le même jour qu’il pourrait reconsidérer les droits de douane de 25 % sur les importations de voitures et de pièces détachées en provenance du Canada, du Mexique et d’autres pays, tentant ainsi de rassurer les alliés des États-Unis dans le cadre de l’accord USMCA et d’éviter d’ouvrir un nouveau front dans la guerre commerciale.
Malgré cet assouplissement partiel, la Maison Blanche a confirmé le maintien des droits de douane de 25 % sur certains produits en provenance du Canada et du Mexique non couverts par l’accord de libre-échange nord-américain, ainsi que des droits de douane de 10 % sur toutes les autres importations dans le monde. Cette politique commerciale fluctuante a conduit l’OPEP à réduire ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole pour la première fois depuis décembre, sur fond de craintes d’un ralentissement économique mondial dû à la guerre commerciale.
11 avril 2025
Nouvelle réponse chinoise et escalade à l’OMC :
Le vendredi 11 avril, la Chine a annoncé une nouvelle escalade dans ses contre-mesures. Pékin a porté les droits de douane sur les importations américaines à 125 % à compter du samedi 12 avril, contre 84 % précédemment.
Cette mesure était une réponse directe à l’augmentation sans précédent des droits de douane sur la Chine décidée par M. Trump. Le gouvernement chinois a déclaré qu’il “ignorerait” toute augmentation future des droits de douane américains, marquant ainsi son refus de céder à de nouvelles extorsions.
En outre, la Chine a déposé une plainte officielle auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) contre les nouveaux droits de douane américains, les considérant comme une grave violation des règles du commerce international. Dans une déclaration ferme, le Comité des tarifs douaniers du Conseil d’État chinois a déclaré que l’imposition par les États-Unis de tarifs douaniers “anormalement élevés” à la Chine violait les lois économiques fondamentales et a blâmé Washington pour les fortes perturbations de l’économie mondiale causées par cette guerre commerciale.
Entre-temps, les marchés mondiaux ont réagi différemment à ces développements. Après une forte baisse en début de semaine, les prix de l’or ont bondi, les investisseurs se réfugiant dans des valeurs sûres, tandis que les prix du pétrole ont commencé à se stabiliser en raison des exemptions américaines et de la reprise des importations de brut par la Chine.
Cependant, en général, un sentiment de prudence et d’incertitude est resté dominant sur les marchés financiers et les marchés des devises, les traders attendant les prochains développements dans ce cycle de conflit commercial.
15 avril 2025
Réactions et avertissements internationaux au plus fort de la crise :
À la mi-avril, la rhétorique politique entourant la guerre commerciale s’est intensifiée. À Hong Kong, Xia Baolong, directeur du bureau des affaires de Hong Kong et de Macao en Chine, a qualifié les droits de douane américains d'”extrêmement grossiers et visant à détruire Hong Kong”, suggérant que Washington utilisait la guerre commerciale comme levier politique contre la Chine sur des questions autres que commerciales.
À Washington, le Trésor américain a cherché à rassurer les marchés en soulignant qu’il était ouvert à un “accord équitable” avec la Chine si celle-ci offrait des concessions tangibles. Dans le même temps, les institutions internationales et les experts économiques ont commencé à tirer la sonnette d’alarme.
JPMorgan, l’une des plus grandes banques d’investissement, a relevé à 60 % la probabilité d’une récession aux États-Unis et dans le monde en raison des droits de douane, avertissant qu’ils “menacent de saper la confiance des entreprises et de ralentir la croissance mondiale”. David Solomon, PDG de Goldman Sachs, a également mis en garde contre l’augmentation de “l’incertitude causée par les nouveaux tarifs douaniers” et le risque d’entrer dans un nouvel environnement économique trimestriel. Il a indiqué des risques importants pour les économies américaine et mondiale, avec la possibilité que les marchés restent “volatiles jusqu’à ce que la clarté apparaisse”.
Selon les estimations du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, la poursuite de l’escalade pourrait coûter des centaines de milliards de dollars à l’économie mondiale et réduire considérablement la croissance mondiale. L’inflation liée aux droits de douane suscite de plus en plus d’inquiétudes, car l’augmentation des droits de douane entraîne une hausse des prix des biens pour le consommateur final, ce qui pourrait contraindre les banques centrales à resserrer leurs politiques monétaires à un moment inopportun. Dans ce contexte, Reuters a rapporté que la vague de tarifs douaniers américains avait poussé les prix à la consommation en Asie et en Europe vers de nouveaux sommets, tandis que les monnaies asiatiques s’étaient dépréciées sous la pression des attentes d’un ralentissement des exportations et des investissements.
L’impact des développements sur les marchés financiers mondiaux
L’escalade de la guerre commerciale a eu un effet immédiat et profond sur les marchés financiers mondiaux, et ses répercussions intéressent particulièrement les traders et les investisseurs. Depuis le début du mois d’avril, les marchés boursiers sont ébranlés à chaque nouveau développement :
Marchés boursiers
Les indices américains et européens ont subi des pertes importantes dès les premiers jours du conflit. L’indice S&P 500 a chuté de plus de 4 % au cours de la première semaine d’avril, tandis que l’indice MSCI Emerging Markets est entré dans une vague de vente, perdant tous ses gains de l’année.
Selon les estimations de CNBC, plus de 5,4 billions de dollars ont été effacés de la valeur des actions mondiales en seulement deux séances, en raison de la panique provoquée par les droits de douane.
Les valeurs industrielles et technologiques ont été particulièrement touchées. Par exemple, les constructeurs automobiles européens ont subi des pressions à la vente après avoir été visés par des droits de douane américains de 25 %, tandis que les entreprises asiatiques du secteur de l’électronique ont vu le cours de leurs actions chuter en raison de problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement.
En revanche, les marchés ont repris leur souffle après l’annonce par les États-Unis de l’exemption des droits de douane pour les téléphones et les ordinateurs, ce qui a entraîné un rebond des valeurs technologiques et une reprise partielle des indices américains. Même Apple, le géant de la technologie, a vu son action augmenter à la suite des exemptions tarifaires. Cependant, la volatilité est restée dominante. Les experts de Goldman Sachs ont décrit la situation comme une situation où les marchés resteraient volatils jusqu’à ce que le résultat des négociations devienne plus clair ou que les décisions contradictoires cessent.
En effet, nous avons vu l’indice Dow Jones fluctuer sur des centaines de points, monter et descendre en quelques jours en fonction de l’actualité, faisant de la gestion du risque un défi quotidien pour les traders.
Marchés des matières premières et des métaux
Face à l’incertitude, les investisseurs se sont clairement tournés vers les valeurs refuges.
L‘or a retrouvé son éclat et s’est stabilisé près de ses plus hauts niveaux enregistrés à la mi-avril. Le prix de l’once a atteint environ 3 211 dollars, après avoir brièvement dépassé les 3 245 dollars le 14 avril.
Ce niveau signifie que l’or a augmenté de plus de 20 % depuis le début de l’année, sous l’effet de l’intensification de la guerre commerciale, qui a assombri les perspectives de croissance mondiale et affaibli la confiance, même dans certains actifs américains traditionnellement sûrs.
D’autre part, les prix du pétrole brut ont été influencés par des facteurs contradictoires. Les craintes d’un ralentissement de l’économie mondiale ont exercé une pression à la baisse sur les prix, tandis que certains facteurs positifs temporaires ont contribué à les soutenir.
Le 15 avril, les prix du pétrole Brent et West Texas Intermediate (WTI) ont légèrement augmenté (~0,2 %), atteignant respectivement 65 et 61,7 dollars le baril. Cette hausse a été soutenue par deux facteurs : Les exemptions de droits de douane accordées par Trump à certains produits électroniques, qui ont ravivé l’espoir d’éviter un coup de frein à la demande énergétique mondiale, et une augmentation de 5 % des importations de pétrole de la Chine en mars sur une base annuelle, en prévision d’une baisse de l’offre iranienne.
Avec l’annonce de l’intention des États-Unis d’accorder des exemptions de droits de douane sur les produits électroniques et de réduire les droits de douane sur les voitures, le marché pétrolier a ressenti un certain soulagement, car cela indiquait une atténuation potentielle de la guerre commerciale, ce qui pourrait réduire le risque d’une baisse de la demande de carburant.
Toutefois, l’OPEP, par mesure de précaution, a revu à la baisse ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole pour la première fois depuis la fin de l’année dernière, en raison de l’incertitude créée par les fluctuations de la politique commerciale des États-Unis.
Il convient également de noter que les prix des métaux industriels, tels que le cuivre et l’aluminium, ont baissé au début du mois d’avril en raison des prévisions de dommages à l’activité industrielle mondiale, avant de se redresser partiellement lorsque des discussions sur des négociations potentielles entre Washington et Bruxelles sont apparues. En général, les négociants en matières premières se sont retrouvés face à une situation complexe : d’une part, une guerre commerciale qui freine la demande mondiale et, d’autre part, des actions et des attentes qui renforcent les espoirs.
Marché des devises
Les taux de change mondiaux ont été marqués par de nettes fluctuations en raison de l’évolution de l’appétit pour le risque.
Les monnaies refuges telles que le yen japonais et le franc suisse ont fortement augmenté au début du mois d’avril, les investisseurs se précipitant vers la sécurité, tandis que les monnaies des marchés émergents ont subi une pression à la vente en raison des craintes de sorties de capitaux.
Le dollar américain est passé sous la barre des 100 sur son principal indice (DXY) au milieu du mois, influencé par les prévisions selon lesquelles les droits de douane pourraient ralentir l’économie américaine et inciter la Réserve fédérale à assouplir sa politique monétaire.
En revanche, le yuan chinois est tombé à son niveau le plus bas en six mois, reflétant les efforts des marchés des changes pour contrer l’impact des droits de douane en dévaluant la monnaie chinoise – une mesure qui pourrait quelque peu alléger le poids des droits de douane sur les exportations chinoises.
L’euro et la livre sterling ont également connu une certaine volatilité, sous la pression des inquiétudes concernant les exportations européennes affectées par les droits de douane de Trump. Elles ont toutefois bénéficié d’un soutien relatif, l’Union européenne ayant fait preuve d’unité dans les négociations et des données européennes meilleures que prévu ayant permis d’atténuer temporairement les craintes.
David Solomon, PDG de Goldman Sachs, a indiqué qu’il y avait “une activité massive sur le marché des devises en ce moment”, les investisseurs se concentrant sur les mouvements du dollar américain et la situation fluctuante.
Cette activité a créé à la fois des opportunités et des risques pour les cambistes. Une forte volatilité signifie un potentiel de profits importants pour ceux qui gèrent bien le timing et les risques, mais elle comporte également des risques élevés de pertes substantielles si les événements s’inversent brusquement.
Conclusion
Dans l’ensemble, la guerre commerciale s’est rapidement reflétée dans l’humeur des marchés mondiaux : l’incertitude a atteint des niveaux rares et les fluctuations quotidiennes des prix des actifs ont suffi à désorienter même les investisseurs chevronnés. Les traders ont suivi de près chaque déclaration ou mouvement en provenance de Washington, de Pékin et de Bruxelles, car les nouvelles politiques peuvent instantanément se transformer en mouvements de prix sur les plateformes financières.
Les investisseurs espèrent maintenant des signes de progrès dans les négociations entre les États-Unis et les pays dont les droits de douane ont été suspendus pendant 90 jours, car toute indication d’un accord se traduirait immédiatement par un soulagement du marché et une augmentation de l’appétit pour le risque.
Analyse économique et motivations des politiques
La récente escalade de la guerre commerciale peut s’expliquer par plusieurs motivations économiques et politiques de la part des différentes parties impliquées :
Motivations américaines
L’administration Trump a adopté une position agressive en matière de commerce, motivée par plusieurs considérations. La première d’entre elles est la réduction du déficit commercial chronique des États-Unis avec des pays comme la Chine, l’Allemagne et le Mexique. M. Trump estime que l’imposition de droits de douane encouragera la relocalisation d’industries aux États-Unis et réduira l’importation de produits bon marché.
Deuxièmement, il y a les demandes liées à la propriété intellectuelle et au transfert forcé de technologies. Washington fait pression sur Pékin pour qu’il modifie les pratiques qu’il juge déloyales à l’égard des entreprises américaines, en les obligeant par exemple à transférer des technologies à des partenaires chinois.
Troisièmement, des raisons géopolitiques et sécuritaires sont entrées dans l’équation commerciale. L’administration Trump a publiquement lié les droits de douane à des questions non commerciales. Par exemple, l’imposition d’un droit de douane supplémentaire de 20 % à la Chine a été justifiée comme une réponse au rôle joué par Pékin dans la crise de la drogue aux États-Unis (la question du fentanyl). Washington a également laissé entendre que la position de la Chine sur des questions telles que Hong Kong et Taïwan pourrait faire partie de la pression commerciale plus large.
En outre, M. Trump cherche à renégocier les accords commerciaux internationaux (comme le remplacement de l’ALENA par l’USMCA) afin d’obtenir des conditions qu’il juge plus équitables pour les États-Unis. Bien entendu, les responsables politiques de la Maison-Blanche sont conscients des coûts nationaux de ces droits de douane, qui constituent en fait des taxes pour les consommateurs américains en augmentant le prix de nombreux produits. Toutefois, l’administration a fait le pari que la douleur ressentie par les partenaires commerciaux l’emporterait sur la douleur ressentie par les États-Unis, ce qui les obligerait finalement à faire des concessions substantielles.
Le PDG de Goldman Sachs a salué l’importance accordée par l’administration à la suppression des barrières commerciales et au renforcement de la compétitivité des États-Unis, tout en mettant en garde contre les risques de cette approche. Cela reflète les divergences d’opinion des entreprises américaines : certaines estiment qu’il est nécessaire de s’opposer fermement aux “pratiques commerciales déloyales” en vigueur depuis des décennies, tandis que d’autres craignent que ce pari tarifaire ne se retourne contre elles en affaiblissant la croissance, en augmentant l’inflation et en entraînant l’économie dans une récession.
Les motivations de la Chine
La Chine a adopté une position ferme en réponse aux pressions américaines, sur la base de considérations économiques et de souveraineté.
D’un point de vue économique, Pékin tient à protéger son modèle de croissance basé sur les exportations. Une réponse modérée pourrait être interprétée comme une faiblesse, ce qui pourrait encourager Washington à formuler de nouvelles exigences. En outre, la Chine dispose d’outils limités pour contrer l’impact des droits de douane (tels que la dévaluation du yuan ou le soutien aux exportateurs) ; elle a donc opté pour une réponse vigoureuse afin de dissuader les États-Unis de poursuivre leur escalade.
En outre, la Chine cherche à gagner du temps pour trouver d’autres marchés et fournisseurs tout en adaptant ses chaînes d’approvisionnement à la nouvelle situation.
Du point de vue de la souveraineté, les dirigeants chinois considèrent les actions de Washington comme une tentative de contenir leur montée en puissance et de perturber leur ascension vers le statut de puissance technologique mondiale (en particulier avec les enquêtes américaines sur les importations de semi-conducteurs et de produits pharmaceutiques visant à imposer de nouveaux droits de douane). La dignité nationale joue également un rôle important ; les responsables chinois ont clairement indiqué que leur peuple “ne cause pas de problèmes mais n’en a pas peur” et que la pression et la coercition ne sont pas le bon moyen de traiter avec la Chine.
La Chine comprend également que l’économie américaine elle-même souffrira de la guerre commerciale, et elle peut donc miser sur sa patience stratégique et sur la pression intérieure aux États-Unis (de la part du secteur des affaires ou des consommateurs) pour faire fléchir Trump. Par conséquent, l’objectif de la Chine est d’éviter de faire des concessions importantes sous une pression directe et d’attendre des conditions de négociation plus équilibrées, que ce soit dans le cadre de discussions bilatérales ou de cadres multilatéraux tels que l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
La Chine a ouvertement accusé les États-Unis de tenter de la “contraindre” économiquement, qualifiant la stratégie de M. Trump de “mauvaise blague”, ce qui sous-entend son inefficacité face à une économie massive et diversifiée comme celle de la Chine.
Positions de l’Union européenne, de la Russie et d’autres pays
Pour l’Europe, les motivations premières sont la protection de ses intérêts industriels et le libre-échange. Les Européens sont mécontents d’être inclus dans le même groupe cible que la Chine, d’autant plus qu’ils partagent de nombreuses critiques de Washington à l’égard des pratiques chinoises.
Bruxelles tente donc de trouver un équilibre entre désescalade et fermeté : elle a proposé un accord “zéro tarif” avec les États-Unis pour tenter de désamorcer la crise, mais a en même temps préparé une liste de contre-mesures d’une valeur de près de 26 milliards d’euros pour cibler les importations américaines si nécessaire.
L’Europe reconnaît qu’une escalade commerciale globale avec les États-Unis nuira considérablement aux deux parties (en particulier aux grandes industries européennes telles que le secteur automobile allemand), c’est pourquoi elle a préféré une approche axée sur la négociation. En se montrant disposée à supprimer les barrières non tarifaires (telles que certaines mesures réglementaires), l’Europe signale à Trump qu’il existe des moyens de répondre à ses préoccupations commerciales sans s’engager dans une guerre commerciale.
En revanche, Peter Navarro, le conseiller commercial de la Maison Blanche, a tenté de compliquer les choses en insistant sur le fait que l’Europe elle-même devait supprimer sa taxe sur la valeur ajoutée de 19 % et abaisser les normes de sécurité alimentaire, entre autres exigences, si elle voulait réduire les droits de douane américains, créant ainsi des conditions difficiles pour parvenir à un accord global.
Quant à la Russie, bien qu’elle soit moins directement impliquée (en raison des sanctions occidentales existantes et du déclin de ses échanges commerciaux avec les États-Unis), elle bénéficie stratégiquement du différend entre les États-Unis et la Chine, qui détourne l’attention de Washington et de Pékin. Moscou a ouvertement soutenu la position de Pékin contre “l’hégémonie américaine” dans le système commercial mondial, considérant l’alliance croissante entre la Chine et la Russie comme une opportunité de construire un bloc économique face aux pressions occidentales.
En outre, la Russie pourrait bénéficier de la recherche par la Chine de fournisseurs alternatifs (par exemple, en augmentant ses achats d’énergie et de produits agricoles à la Russie pour compenser les importations américaines). Cependant, Moscou a été indirectement affectée par la baisse des prix du pétrole et leur volatilité en raison des prévisions d’un ralentissement de la croissance mondiale.
D’autres pays asiatiques, comme l’Inde, le Brésil et l’Asie du Sud-Est, tentent de saisir les opportunités et d’éviter les dommages simultanément. L’Inde – comme mentionné précédemment – a choisi une approche de négociation pour améliorer son accord commercial avec les États-Unis (comme la réduction des droits de douane sur certains produits américains en échange d’exemptions), et elle pourrait tirer profit de la tension entre Washington et Pékin en attirant certains investissements ou en augmentant ses exportations agricoles vers la Chine.
Des pays comme le Viêt Nam et Taïwan pourraient connaître des changements dans leurs chaînes d’approvisionnement, les multinationales cherchant des alternatives à la Chine pour éviter les droits de douane, ce qui pourrait leur être bénéfique à long terme. Toutefois, ils sont également menacés à court terme par la réduction de la demande mondiale et la perturbation des échanges commerciaux.
En général, les économies qui ne sont pas directement impliquées dans le conflit tentent de rester relativement neutres et de tirer parti de tout détournement de trafic en leur faveur, tout en avertissant qu’elles pourraient être amenées à agir si elles sont lésées.
Fitch Ratings a souligné que l’augmentation des droits de douane américains menaçait la cote de crédit de nombreux pays d’Asie-Pacifique en raison de leur forte exposition, bien que les droits de douane de 10 % imposés à la plupart des pays aient été moins sévères que les scénarios les plus pessimistes envisagés précédemment par l’agence.
Impacts macroéconomiques attendus
La plupart des experts s’accordent à dire que la poursuite de l’escalade sans résolution aura un impact négatif sur la croissance économique mondiale. Des droits de douane élevés signifient une augmentation des coûts de production pour les entreprises (celles qui importent des matières premières ou des pièces), ce qui peut les inciter à augmenter les prix des produits finis, à réduire les marges bénéficiaires, voire à retarder les plans d’investissement.
Cette situation mine la confiance des entreprises mondiales, comme l’a noté JPMorgan, et rend les dirigeants plus prudents en matière d’embauche et d’expansion. Le Fonds monétaire international (FMI) a averti que ces tensions commerciales majeures pourraient entraîner de fortes corrections sur les marchés boursiers mondiaux et des fluctuations monétaires volatiles si elles n’étaient pas résolues.
Lorsque l’incertitude augmente, les ménages retardent généralement leurs achats importants et les entreprises réduisent leurs dépenses d’investissement, ce qui affaiblit la demande globale. En effet, de grandes banques d’investissement comme Goldman Sachs et Bank of America ont revu à la hausse leurs prévisions concernant la possibilité d’une récession au cours de l’année à venir.
Les modèles économiques montrent que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine pourrait à elle seule réduire la croissance économique mondiale d’environ 0,5 à 0,8 point de pourcentage sur deux ans, en raison d’une diminution des volumes d’échanges et d’investissements. Elle entraîne également une redistribution inefficace des ressources, car les entreprises sont obligées de réorganiser leurs chaînes d’approvisionnement à grands frais, et certaines industries peuvent délocaliser des sites à faibles coûts vers des sites plus coûteux mais moins risqués sur le plan politique, ce qui se traduit par une hausse des prix des produits de base au niveau mondial.
Bien entendu, le consommateur final paiera une partie du prix : les droits de douane étant essentiellement un impôt indirect, les taux d’inflation devraient augmenter, en particulier aux États-Unis (où de nombreux biens de consommation sont importés de Chine). Des rapports économiques ont indiqué que les récents tarifs douaniers de Trump menacent d’enflammer l’inflation et de pousser l’économie mondiale au bord de la récession si des accords ne sont pas conclus pour y remédier.
D’un autre côté, certains affirment que la pression commerciale peut conduire à un système commercial plus équilibré à long terme si de nouveaux accords sont conclus. Par exemple, la Chine pourrait ouvrir davantage ses marchés financiers et agricoles aux investisseurs et exportateurs américains pour apaiser la colère de Washington, et les principales nations industrielles pourraient accepter de réformer l’Organisation mondiale du commerce et de s’attaquer aux problèmes liés aux subventions industrielles et aux transferts forcés de technologie. Toutefois, ces résultats positifs potentiels sont encore incertains et entachés de complexités politiques.
Avertissements et attentes futures
À la lumière de ces développements, de sérieuses mises en garde et des prédictions variées ont été émises quant à l’avenir proche de la guerre commerciale mondiale :
Avertissements des experts et des institutions internationales
Dans son dernier rapport, le Fonds monétaire international (FMI) avertit que la poursuite de l’escalade commerciale actuelle pose un “risque significatif” pour l’économie mondiale et pourrait conduire à un scénario de récession mondiale si la confiance s’érode et si les investissements diminuent. La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a confirmé que les conséquences directes de cette guerre commerciale seraient une hausse de l’inflation, une baisse de la croissance économique, voire une récession si rien n’est fait pour y remédier.
L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a également exprimé sa vive inquiétude. Le directeur général de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a déclaré que les récentes mesures prises par les États-Unis pourraient compromettre le système commercial multilatéral et encourager d’autres pays à adopter des politiques similaires, menaçant ainsi de démanteler les règles qui régissent le commerce mondial depuis des décennies.
Outre le FMI et l’OMC, les grandes banques d’investissement ont relevé la probabilité d’une récession (JPMorgan 60%, Goldman Sachs 45%) et ont commencé à esquisser des scénarios difficiles pour les marchés :
HSBC a qualifié les prévisions de croissance de la Chine en 2025 de “plus sombres”, tandis que Fitch a mis en garde contre la possibilité d’abaisser la note de crédit de plusieurs pays si les tensions persistent et se traduisent par une expansion financière ou une baisse significative des exportations.
Ces institutions craignent un cercle vicieux : Tarifs → Hausse des prix → Baisse de la demande → Ralentissement économique → Instabilité financière → Mesures plus protectionnistes en guise de réponse politique.
Des appels clairs ont donc été lancés pour éviter ce cycle : L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a exhorté toutes les parties, par le biais d’une déclaration spéciale, à faire preuve de retenue et à revenir à la table des négociations, car le seul bénéficiaire d’une guerre commerciale prolongée “ne sera personne”.
Prévisions concernant la guerre commerciale
À court terme (3 à 6 mois), les analystes prévoient que la situation restera tendue, avec la possibilité de négociations partielles. Les États-Unis et leurs alliés (UE, Japon, Canada, Mexique, etc.) disposent d’une fenêtre de 90 jours (jusqu’au début du mois de juillet 2025) pour conclure des accords commerciaux afin d’éviter la réactivation des droits de douane suspendus.
Un optimisme prudent permet de penser que cette période pourrait donner lieu à des concessions mutuelles : Par exemple, Washington pourrait reporter indéfiniment les droits de douane de 10 % imposés à l’Europe si celle-ci accepte de réduire certaines barrières réglementaires et d’augmenter les importations d’énergie américaine.
Les négociations entre les États-Unis et l’Inde devraient également se poursuivre, en vue d’une percée avant la visite prévue du Premier ministre Modi à Washington à l’automne, dans le but de conclure un mini-accord commercial pour résoudre le différend sur les droits de douane de 26 %.
D’autre part, la voie des États-Unis et de la Chine semble plus compliquée. À la mi-avril, il n’y avait aucun signe de reprise des négociations à haut niveau entre les deux ; en fait, la rhétorique enflammée des deux parties ne fait que renforcer l’impression que le fossé s’est creusé.
Toutefois, une percée diplomatique soudaine n’est pas exclue, peut-être par la médiation d’un tiers ou une rencontre imprévue entre le président Trump et le président chinois Xi Jinping lors d’un sommet international, en particulier si les pertes économiques commencent à apparaître clairement dans l’économie de l’un ou l’autre des pays.
Scénarios possibles de désescalade
Un scénario possible de désescalade serait que Washington et Pékin conviennent d’un nouveau cessez-le-feu qui rétablirait les droits de douane à leur niveau d’avant avril en échange de l’engagement de la Chine à augmenter de manière significative ses importations de produits américains (tels que l’énergie et l’agriculture) au cours de la période 2025-2026, d’autres réformes structurelles devant être discutées ultérieurement. Ce scénario est soutenu par le désir urgent de stabilité sur les marchés, mais il nécessite une volonté politique flexible qui pourrait ne pas être facilement disponible dans l’environnement polarisé actuel.
Possibilités d’une nouvelle escalade
Si les efforts diplomatiques échouent, nous pourrions assister à une nouvelle escalade après la fin de la période de 90 jours. Les États-Unis ont menacé d’imposer des droits de douane sur les importations de semi-conducteurs et de médicaments, des secteurs très sensibles pour le commerce mondial.
L’annonce par Trump d’un nouveau tarif douanier sur les semi-conducteurs importés, prévue pour la dernière semaine d’avril, pourrait déclencher une confrontation technologique plus large.
Pour sa part, la Chine dispose d’armes non traditionnelles auxquelles elle pourrait recourir si la guerre se poursuit, notamment en restreignant les exportations de minéraux rares essentiels pour les industries américaines (ce à quoi elle a commencé à faire allusion) ou même en dévaluant davantage le yuan pour compenser les effets des droits de douane, bien que cela puisse provoquer une colère encore plus grande de la part des États-Unis.
En outre, Pékin pourrait resserrer son emprise sur les activités des multinationales américaines opérant en Chine en guise de pression (par le biais de retards réglementaires ou de campagnes de boycott informelles).
Par ailleurs, des facteurs politiques internes pourraient également alimenter l’escalade : Alors que les États-Unis entrent dans le cycle des élections présidentielles de 2026, Donald Trump pourrait considérer le durcissement des positions commerciales comme un moyen de rallier sa base électorale sous la bannière de la protection des travailleurs américains. De même, il est peu probable que les dirigeants chinois fassent preuve de faiblesse à l’égard de leur population ou de leurs voisins.
En général, la phase actuelle est caractérisée par un haut degré d’incertitude. Les experts conseillent aux investisseurs et aux négociants d’être prudents et de se protéger contre la volatilité, car les nouvelles politiques sont devenues le principal moteur des marchés à court terme.
En outre, la planification des entreprises est devenue un défi, car les décisions d’investissement dépendent de l’issue de ces batailles tarifaires. Toutefois, on peut espérer que les conséquences négatives évidentes pousseront toutes les parties à faire des compromis. Compte tenu de la nouvelle réalité – “tout le monde est perdant”, comme l’a décrit Bloomberg -, le pragmatisme économique pourrait finir par l’emporter sur la rhétorique intransigeante. D’ici là, la guerre commerciale mondiale restera la principale source d’instabilité, les responsables des marchés surveillant de près si les semaines à venir apporteront une avancée négociée pour mettre fin à l’escalade ou si nous nous dirigeons vers une phase plus intense de cette confrontation sans précédent.